LUCIENNE, LECTRICE
volume
1

Etrange
destin pour ces livres. Je les ai sorti du purgatoire
lorsque nous nous sommes séparés de la maison familiale.
Ils dormaient dans des grands sacs au grenier depuis plus
de trente ans. Nous les avions déposés là au décès de ma
grande tante. Je ne crois pas que les avions garder pour
les lire, mais simplement parce que c’était ses
livres. De plus certains avaient des illustrations
vieillottes avec un certain charme. Je me souviens que dans
sa cuisine, ou régnait un joyeux désordre, Il y avait
entassé sur une table, des piles de journaux et de livres
en tout genre. Seule, Lucienne pouvait retrouver quelque
chose sur cette table. Derrière, en tendant le bras, on
pouvait atteindre une antique radio, qui diffusait les
épisodes de Zappy Max et les déambulations de «
l’ami Bartissol ». Elle avait toujours dans son
porte monnaie des capsules de Bartissol au cas ou…
je n’ai pas de souvenir de Lucienne en train de lire,
à l’exception des livres de messe, dont elle faisait
un usage intensif. Elle était surtout la reine du crochet,
réalisant de superbes napperons sans compter les jours sur
les draps et toutes sortes de lettres pour marquer le
linge. On peut supposer que dans cette vie pas toujours
facile, avec son garde chasse de mari, et toutes ses années
de veuvage, la lecture de ces livres moralisateurs, avec
happy end, lui a apporté un peu de douceur dans ce monde de
brute. En lisant certain passage, il est étonnant de
constater, qu’elle a connu des scènes décrites dans
ces livres. En effet, par sa proximité avec l’univers
du château de Boran, côté domestique, elle connaissait bien
les us et coutumes de ce milieu.
Lucienne avait un don pour l’organisation, elle
collectionnait les recettes de cuisine, soigneusement
découpées et collées bord à bord dans des cahiers. Je
n’ai pas de souvenir précis de sa cuisine, mais je me
souviens, du vin qui chauffait sur la petite cuisinière
dans la pénombre. Il y avait comme de la magie lors de
l’embrasement de l’alcool dans la casserole. A
ce moment là, j’étais pas loin de penser que Lucienne
avait quelques secrets de sorcière ! Elle possédait
également une sérieuse collection de chansons en tout
genre. Outre des partitions achetées dans le commerce, elle
avait de nombreux petits cahiers qui étaient gorgés
jusqu’au moindre espace de paroles ! Le plus
délicat, aujourd’hui, c’est de pouvoir relire
ces textes, écrits très finement au crayon ! Enfin
concernant les livres, elle avait mis en place des listing
répertoriant les auteurs et les titres des livres. Souvent
pour les plus gros volumes, elle prenait soin de les
recouvrir en utilisant du papier de récupération. En voici
donc, une modeste sélection, résultant d’un carottage
tout à fait aléatoire. Bonne
lecture…

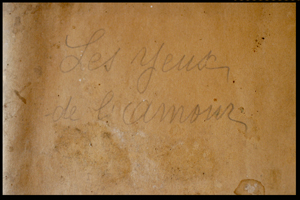
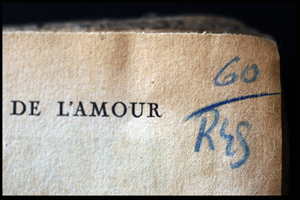
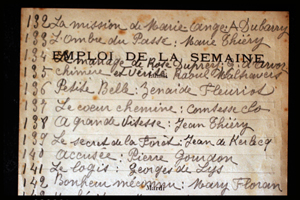
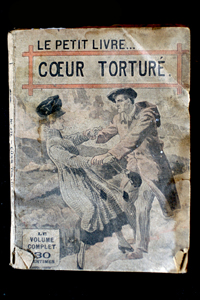
Geneviève,
non, vous ne m’aimez pas !
- Comment pouvez-vous parler ainsi, Claude, quand
j’ai remis ma destinée entre vos mains ? J’ai
risqué sans hésité une aventure redoutable parce que je ne
voulais plus être désormais à un autre que vous.
- -Et pourtant vous refusez de m’appartenir !
- - Je veux conserver le droit de vous regarder sans rougir
de honte quand vous serez mon mari. Ne sentez-vous pas à
quel point il faut que j’ai confiance en vous pour
vous avoir suivi, moi si nerveuse et craintive, à travers
les solitudes de la montagne ? Il suffit que vous soyez
avec moi, je n’ai plus peur de rien.
- - Une femme suit toujours son libérateur. Je vous ai
affranchie d’un esclavage ? arrachée à un misérable
que les plus bas calculs ont seuls déterminés à vous
épouser et qui ne sait reconnaître ni votre nature
d’élite, ni même votre charme physique. Par moi
l’espoir vous est rendu…
- Je vous en ai de la gratitude. Prétendez-vous
m’obliger à vous en payer la dette ?...
Encore une fois, ma présence ne prouve-t-elle pas que je
vous aime ?
Non encore une fois elle prouve seulement votre horreur de
l’autre…de cet homme qui est votre mari et
auquel je porte une haine Féroce parce qu’il a eu le
droit de pénétrer votre chair. Il me semble que je deviens
fou, quand je pense qu’il a tenu votre corps entre
ses bras et que vous ne lui avait pas résisté…
- Ah ! taisez-vous, Claude, taisez-vous ! Je ne vous
croyais pas si cruel.
- -Je le suis moins que vous ! Votre corps était mon bien,
vous n’auriez jamais dû le livrer à un
autre…et aujourd’hui vous vous refusez, à moi
qui ai sur vous des droits supérieurs à tous les décrets
humains.
- Le respect même de notre amour, Claude, me commande de
refuser, et vous devriez être le premier à le comprendre ?
N’oubliez pas non plus que je suis mère…
Roman
inédit de Jean Petithugenin
Edition Ferenczi-1918


Possesseur
d’une fortune agréable, libres d’entraves , le
fils de son père était marqué par un mariage de convenances
bourgeoises et l’éducation d’une nombreuse
postérité. Mais le fils de sa mère n’avait pu
supporter l’idée d’un bonheur officiel et
légal, donc fade, aux côtés d’une jeune personne
présentée par ses parents, comme les demoiselles souhaitées
sur des pancartes manuscrites, à la devanture des
merceries.
D’ailleurs il ne s ‘estimait séduisant,
irrésistible, que dans ses songeries, quand il enlevait des
princesses sous son bras gauche, tandis qu’il
massacrait du bras droit, en même temps que du feu de ses
regards, une troupe d’estafiers apostés sous le
balcon par un père rigide ou un rival sans courage. Là, il
était Stéphane de pied en cap.
Dans le tran-tran journalier, il redevenait Ledoux,
manquait de confiance en ses mérites, n’osait aspirer
à d ‘ élégantes et jolies fiancées qu’il
eût convoitées de tout son cœur, et dédaignait celles
qui, selon lui, eussent pu l’accepter volontiers,
étant ordinaires et quelconques.
Au sortir du collège il avait cherché une carrière ou il
pût exercer ses facultés chevaleresques, il avait fait son
droit dans l’espoir de défendre un jour avec éclat,
de sauver, à la barre, la vie ou l’honneur
d’une jeune fille du peuple persécutée par le rejeton
déclassé d’une famille de la plus haute race, ce qui
se voit couramment. Entré chez un avoué, l’étude
aride d’un code dont les articles sont appréciés en
sens inverses dans les mêmes cas, par les mêmes tribunaux,
et surtout la barbarie d’un jargon de procédure
l’avait rebuté tout d’abord, car il
n’avait pas le don des langues étrangères.
Penchés sur les dossiers crasseux pleins de papiers timbrés
nauséabonds, la tête dans ses mains, l’esprit
chevauchant ses chimères, il lui arrivait de sursauter,
interpellé par un maître-clerc narquois.
Ledoux ! Hé ! Ledoux, où êtes –vous encore.
Parbleu, Ledoux était à sa place, assis devant le
« corbillard ». C’est ainsi qu’on
appelle, de par une ancienne tradition, le pupitre des
clercs amateurs.
Mais il écarait vite, avec une rancune ingrate dont il
avait honte, cette vision rendue pénible par l’idée
du mari, personnage qui prenait dans l’éliognement
une apparence fantastique et hostible, il oubliait, en
regardant Germaine, tout ce qui n’était pas
d’elle, et l’amére psychologie nous enseigne
qu’une joie n’tteint sa plus grande
intensitéqu’au prix d’ un léger remords.
Ce mois de juin s’écoula sous un ciel d’une
splendeur immuable, il osa un jour formuler une proposition
longuement méditée, et demanda timidement à la
marquise :
Philippe Maquet. Edition « petit écho de la mode »
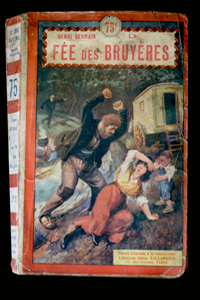
Cette femme était la veuve en premières noces, du Comte de
Chandenay, remariée depuis dix ans avec monsieur de
Kervelen.
-Ainsi disait Georges, d’un accent exaspéré, vous
refusez de me venir en aide, de me sauver de la
misère ? C’est incompréhensible !
- C’est très sage au contraire, répartit froidement
Mme de Kervelen. Ce faisant je sauvegarde tes intérêts
futurs, ton avenir.
-Eh ! que me fait à moi cette sollicitude trop
éclairée, si elle me réduit à mourir de faim à trente ans
en pleine force, en pleine jeunesse, sous prétexte de
m’assurer de quoi vivre lorsque je serai vieux et las
de tout !
- C’est justement lorsque les années arrivent,
qu’il faut être assuré contre le malheur.
« d’ailleurs continua durement Mme de Kervelen,
en se levant hautaine, cessons une argumentation inutile.
Je ne veux, ni ne puis te donner les cent mille francs que
tu sollicites de ma pitié maternelle. Si j’avais la
faiblesse de t’accorder ce subside, sans le
consentement préalable de Mr de Kervelen,
j’encourrais son blâme justifié. De plus ce serait te
fournir bénévolement les moyens de commettre, sans doute,
de nouvelles folies.
- Oh ! le temps des folies est passé, ma mère ;
depuis quelques années j’ai souffert et j’ai
appris à vivre.
-Oui en dévorant les cinq cents mille francs qui te sont
échus de la succession de ton père, en moins de six ou sept
ans.
-A ce prix là, on peut apprendre à vivre ; les leçons
coutent cher !
- Ce sont celles que t’ a données, sans doute, ton
cher cousin, Jacques de Roberville, ce débauché !
- Ma mère, je vous en prie ne parlez plus de ce passé très
proche encore, et pourtant si loin de mon esprit. Je ne
vois plus Jacques de Roberville, j’ai compris, bien
que tardivement , peut-être, combien sa fréquentation
m’était nuisible.
-Ah ! voici un premier aveu.
-Oh ! je pourrais en faire d’autres ; je
connais mes tords et je n’ai pas la lâcheté de
vouloir les dissimuler. Si je suis revenu ici, en ce
château qui fut mon berceau, avec l’intention
d’implorer de votre tendresse maternelle un secours
indispensable, ce n’est plus pour le jeter bêtement
sur le tapis vert des tripots ou pour le gaspiller en
folies. Non, j’ai maintenant le désir très sincère de
réparer mes fautes de jeunesse. Je voudrais trouver, avec
l’aide de ces cent mille francs, une situation
industrielle ou commerciale.
- Un Chandenay, commerçant, ce serai joli ! jeta Mme
de Kervelen, d’un accent méprisant.
-Ma mère le travail n’est pas déshonorant.
- Il ne me plait pas de discuter de cette opinion, encore
moins de me prêter à la réalisation d’idées aussi
déplacées chez un homme de ta naissance.
-Alors vous refusez de me venir en aide ?
-Absolument.
Vous êtes une mauvaise mère !
…L’aurore succède à la nuit ; sa lumière
efface les ténèbres, endort les douleurs, engendre la vie,
et crée le bonheur !
Croyez et espérez, mes enfants !...
Henri
Germain, la Fée des bruyères.
Société d’éditions jules Tallendier
paris.
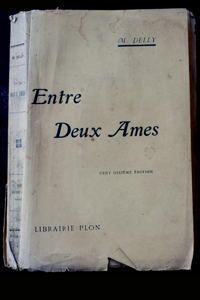
-Je
croyais que vous n’aviez jamais quitté ce petit coin
de province, mademoiselle ? Cependant vous paraissez
fort instruite…
- J’ai été élevée jusqu’à seize ans chez les
Bénédictines de Saint Jean, tout prés d’ici, où les
études sont poussées très fortement sous l’impulsion
d’une abbesse remarquablement douée. Ici dans mes
rares moments de loisir je travaillais encore… Mais
il ne faudrait pas penser trouver en moi
l’instruction moderne, si étendue, si variée,
ajouta-t-elle avec un sourire, sourire timide et délicieux,
qui communiquait à sa physionomie un charme inexprimable.
- Oh ! je n’y tiens pas, je vous assure !
dit-il avec vivacité. On bourre nos jeunes filles modernes
de connaissances de toutes sortes, mais, bien souvent
qu ‘en reste-t-il ?
Moi !, vous plaisantez ! comment
voulez-vous ?... Je serais absolument
incapable…
Elle savait en effet, par ce que lui en avaient dit Mme
d’Oulignies et la femme du notaire, ce qu’était
la saison des chasses au château d’Arnelles :
une suite ininterrompue de réceptions fastueuses, de
distraction mondaines, de sports en tout genres, qui
réunissaient à Arnelles la société la plus aristocratique
et la plus élégante.
- Ce n’est pas du tout mon avis, riposta-t-il
tranquillement. J’ai constaté que vous étiez une
remarquable maîtresse de maison, que la domesticité était
conduite par une main très ferme, que tout marchait à
merveille dans votre intérieur. Il en sera de même,
j’en suis persuadé, lorsque nos hôtes seront là.
D’ailleurs le maitre d’hôtel, le chef et la
femme de charge vous faciliteront bien votre tâche par
l’habitude qu’ils ont de ces réceptions. Ma
sœur Claude qui viendra passer, je l’espère,
deux mois près de nous, vous aidera de très bon cœur,
et pour les petits détails de code mondain qui vous
gêneraient, je serai toujours à votre entière disposition.
Elle le regardait avec un si visible effarement qu’il
ne put s’empêcher de rire.
M
Delly : Entre deux ames.
Librairie Plon. Paris
Déposé au ministère de l’intérieur en
1913.
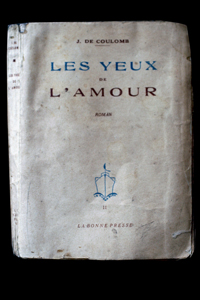
_

Lorsque
la porte se rouvrit devant une nouvelle visiteuse, une
jeune femme de silhouette élégante dont le voile de grand
deuil, le teint décoloré, les yeux soulignés de larges
meurtrissures, racontaient une douleur récente, doublée
peut-être de l’inquiétude du lendemain.
La secrétaire avait beaucoup souffert dans sa vie déjà
longue de veuve et de mère, crucifiée par la guerre, et
peut-être à cause de cela, compatissait-elle, mieux
qu’une autre, aux misères de toutes sortes sur
lesquelles chaque jour, elle se penchait. Tout de suite
elle eut pitié, et, se soulevant, dans un geste
d’accueil, elle dit à l’arrivante :
Madame, veuillez vous asseoir, vous m’exposerez
ensuite l’objet de votre visite.
L’inconnue s’assit. Elle avait des manières
aisées. Pour celle qui l’observait et qui avait connu
naguère les obligations, inhérentes aux femmes de grands
chefs, il était clair qu’elle appartenait à un milieu
distingué.
Pauvre enfant ! soupira le prêtre, vous avez souffert
encore. Ne vous plaignez pas… La douleur, quand elle
est bien acceptée, est pour nos âmes, le meilleur des
remède. Beaucoup ne le comprendront point… Ils la
fuient ou la brave… Ils ne l’acceptent pas
comme une rédemption…
- J’ai été de ceux-là.
- et maintenant ?
- J’éprouve l’impression d’avoir devant
moi, comme le matin dans la montagne, un rideau de
brouillard rose qui me laisse l’espérance que le
soleil le percera, et alors je ne m’abandonne plus à
ma peine…
- Celle-ci, peu à peu, vous fait connaître les vraies
valeurs de la vie. Et je ne m’en étoone point. La
douleur en effet lorsqu’elle est bien supportée,
détruit en nous ce qui doit mourir, pour que grandisse la
grâce.
Les mains que Françoise joignait sur son petit sac,
frémissaient imperceptiblement. Elle sentait en elle un
dernier espoir trop fou, trop humain, sur lequel elle ne
voulait pas s’appesantir. Devrait-elle mourir
aussi ?
J de Coulomb : Les yeux de l’amour.
Illustrations de Jean Aujame.
Maison de la bonne presse/Paris



