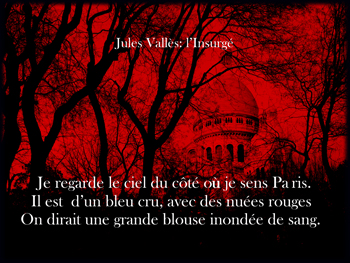COMMUNE DE PARIS, LA
SEMAINE SANGLANTE
21 au 28
MAI 1871

Quand
la foule aujourd'hui muette, comme l'océan
grondera,
Qu'à
mourir elle sera prête, la Commune se
lèvera.
Nous
reviendrons foule sans nombre, nous viendrons nous serrant
les mains.
La
mort portera la bannière ; le drapeau noir crêpe de sang
;
Et
pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel
flamboyant.
Louise
Michel, mai 1871

30 000 insurgés seront tués dont 3 500 fusillés dans
Paris sans jugement, 1900 le seront cour de la Roquette et
plusieurs centaines au "Mur des fédérés" du
Père-Lachaise.
40
000 prisonniers seront internés, dans les pires conditions,
sur des pontons flottants et dans des places et enceintes
fortifiées.
10
137 personnes dont 657 enfants, 47 de 13 ans et 26 de 12
ans et moins, seront condamnées aux travaux forcés, à la
déportation dans une enceinte fortifiée, à un
emprisonnement de moins d'un an ou de plus d'un an et, pour
les mineurs, à la détention en "maison de
correction".
35
conseils de guerre improvisés siégeront encore pendant deux
ans pour "juger" toutes les personnes
arrêtées.
"20
000 hommes, femmes, enfants tués pendant la bataille ou
après la résistance à Paris et en province ; 3000 au moins
morts dans les dépôts, les pontons, les forts, les prisons,
la Nouvelle-Calédonie, par l'exil ou les maladies
contractées pendant la captivité ; 13 700 condamnés à des
peines qui, pour beaucoup, ont duré neuf ans ; 70 000
femmes, enfants, vieillards privés de leur soutien naturel
ou jetés hors de France ; 107 000 victimes environ, voilà
le bilan des vengeances de la haute bourgeoisie". (P.O.
Lissagaray "Histoire de la Commune de
Paris")
"Dimanche
matin, sur plus de 2000 fédérés, 111 d'entres eux ont été
fusillés et ce, dans des conditions qui démontrent que la
victoire était entrée dans toute la maturité de la
situation". (G. Gallifet, général
Versaillais).
"Quand
les hommes rendent leurs armes, on ne doit pas les
fusiller...cela était admis. Malheureusement, sur certains
points on a oublié les instructions que j'avais données". (
Mac-Mahon, maréchal nommé par Thiers commandant de l'armée
de Versailles).
"On
tuait partout, on tuait sans trêve. C'était le délire du
massacre, et ces sanglantes saturnales allaient se
prolonger pendant quatre jours à la lueur des maisons
enflammées. C'est par milliers que les cadavres des
"fusillés en masse" s'entassaient dans les rues des
Abbesses, Lepic, des Poissoniers, au Moulin de la Galette,
au Château-Rouge. Le 28 mai on vidait l'immense fosse
commune creusée au milieu de la place. Les cadavres, à
moitié décomposés, étaient chargés dans des tapissières.
Tous les spectateurs étaient pleins d'effroi. Une jeune
fille qui assistait à ce spectacle dit : j'en ai vu bien
d'autres, dans un trou on a fourré 150 gardes nationaux".
(Récit d'un témoin)
"Le
cadavre est à terre mais l'idée est debout". (Victor Hugo,
parlant de la Commune).
Le
26 mai, le général
s'emparait du faubourg Saint-Antoine et parvenait au
pied du cimetière du Père-Lachaise, où se tenait "la
vieille garde"des fédérés, ceux qui préféraient la mort à
la fuite. Ceux qui ne s'étaient pas fait tuer sur leurs
canons encloués furent adossés à un mur de ce cimetière,
qui devait acquérir une si lugubre célébrité, et
impitoyablement massacrés.
Le
28 mai cette proclamation était affichée sur les murs de
Paris :
"
travail et la sécurité vont
renaître.République
française. Habitants de Paris L'armée de la France est
venue vous sauver. Paris est délivré. Nos soldats ont
enlevé, à quatre heures, les dernières positions occupées
par les insurgés. Aujourd'hui la lutte est terminée ;
l'ordre
images de
la répression


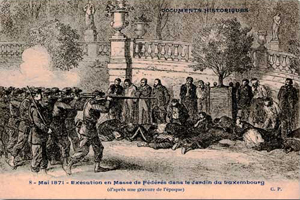
la
répression fut atroce et démesurée (…).
Les vainqueurs s’efforcèrent de sauver les apparences
en établissant des cours martiales (…) mais les
excès de la répression furent tellement évidents que
personne ne crut sérieusement que les lois du pays étaient
respectées".
"Lorsqu’ils avaient conquis un quartier, les soldats,
quelque fois avec l’aide de la police, procédaient à
des perquisitions… (…) Ces opérations furent
suivies de milliers d’arrestations arbitraires et
d’exécutions sommaires… ".
Ce déchaînement "ne fut pas le fait d’une soldatesque
incontrôlée… (…) Les soldats restèrent sous
le contrôle de leurs officiers même si les partisans de
Versailles essayèrent parfois de soutenir le contraire pour
justifier certains excès".
"Les pires excès de l’armée furent exécutés sur des
ordres venus d’en-haut".
"J’ai vu fusiller à la barricade du faubourg
Saint-Antoine une femme qui avait son enfant dans les bras.
L’enfant avait six semaines et a été fusillé avec la
mère. Les soldats qui ont fusillé cette mère et son enfant
étaient du 114ème de ligne. On l’a fusillée pour
avoir dit : "Ces brigands de Versailles ont tué mon
mari". On a fusillé la femme d’Eudes, enceinte de
sept mois. Elle avait une petite fille de quatre ou cinq
ans qui a disparu. On la dit fusillée aussi. À la petite
Roquette, on a fusillé environ deux mille enfants trouvés
dans les barricades et n’ayant plus ni père ni mère".
(Témoignage de Marie Mercier, extrait des archives de
Victor Hugo).
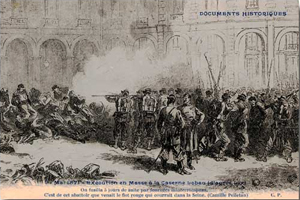
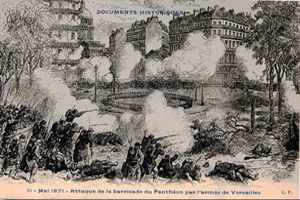


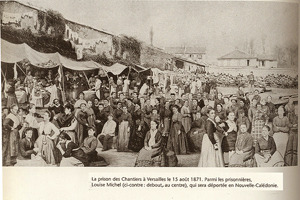
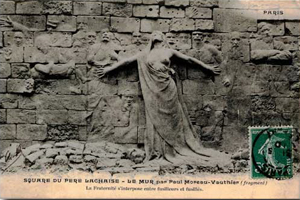

Hommage aux communards, la Semaine Sanglante
Travail photographique
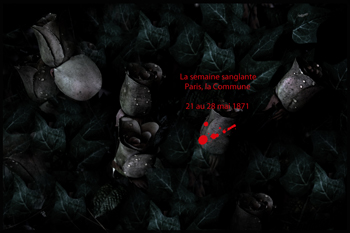
 Théophile Ferré
Théophile Ferré 
Au cours de ce procès, Ferré refuse de se défendre.
Cependant, accablé de calomnies, il rédige une lettre dans
laquelle il se défend, mais que le tribunal ne lui
permettra pas de lire. Il est condamné à mort le 2
septembre 1871 et exécuté, en même temps que
Louis Rossel
et le
sergent Pierre Bourgeois
au camp de
Satory
à
Versailles
le 28 novembre.
 Louis Rossel
Louis Rossel 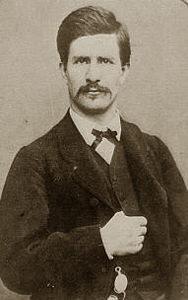
Louis
Rossel ne souhaitant pas prendre le pouvoir total,
démissionne avec éclat, mais ne fuit pas la Commune.
Certains membres du Comité de Salut public (notamment Pyat)
veulent sa mort tandis que d'autres le considèrent comme
leur seul espoir. Rossel reste à Paris, caché dans un hôtel
du boulevard Saint-Germain. Il préfère être « du côté
des vaincus, du côté du peuple
Les Versaillais l'arrêtent, le jugent deux fois. La famille
nîmoise de Louis-Nathaniel, des étudiants parisiens, des
notables de Nîmes, de Metz, de Montauban, des protestants,
Victor Hugo le colonel Pierre Denfert Rocherau et de
nombreux intellectuels le défendent, en vain. Adolphe
Thiers propose à Louis Rossel de le gracier s'il s'exile à
vie. Il refuse, voulant assumer ses responsabilités, ne
voulant pas trahir son pays et ses convictions ni soulager
la conscience de Thiers.
Il est fusillé le28 novembre 1871, à l'âge de vingt-sept
ans, au camp de Satory en même temps que Théophile Ferré et
le sergent Pierre Bourgeois.
D'un point vue juridique, la sentence était pourtant
illégale et constituait une erreur judiciaire. Son
exécution était, pour Adolphe Thiers, motivée
politiquement : « Il fallait faire un
exemple. »
 Jean-Baptiste Millière
Jean-Baptiste Millière 
ll
soutint la Commune de Paris lorsqu’elle
s’imposa en mars 1871 et il se trouvait dans la
capitale lorsque commença la guerre entre la Commune et le
gouvernement versaillais.
Il ne prit pas part aux hostilités et se trouvait chez son
beau-père, rue d’Ulm, voisine du Panthéon lorsque les
Versaillais reprirent Paris. Il est arrêté le 26 mai. Par
ordonnance du général de Cissey , le capitaine Garcin le
fusilla en le forçant à s’agenouiller sur les marches
du Panthéon exécution sommaire illégitime en raison de son
immunité de parlementaire. Sa veuve fut néanmoins déboutée
dans son procès intenté contre Garcin, promu général, par
le tribunal qui se déclara incompétent. Ses dernières
paroles furent « Vive
l’humanité ! ».
 Jaroslaw Dombrowski
Jaroslaw Dombrowski
Officier
polonais, quartier-maître dans l'armée russe, il prépara à
l'insurrection de 1863contre
la Russie,
fut condamné à la déportation en Sibérie,
s'évada pour la France
où
il combattit en tant que général de la
Commune
de Paris Chargé
de la défense de celle-ci, il mourut sur les barricades.
Le 22 mai,
au plus fort de la bataille des barricades, un témoin
raconte qu’on voit Dombrowski sur son cheval noir
conduisant, rue de Rivoli, un bataillon qui chante le Chant
du départ à l’assaut de l’ennemi. Le 23, il est
mortellement blessé sur la barricade de la rue Myrrha, et
décède à l’hôpital Lariboisière. Son corps est
transporté au Père-Lachaise, où il sera inhumé,
« revêtu
de son uniforme et enveloppé dans un drapeau
rouge ».
Sur le chemin du cimetière, à la Bastille, ses camarades de
combat lui rendent un dernier émouvant hommage, ainsi
rapporté par l’historien
Lissagaray :
« Les
fédérés de ces barricades avaient arrêté le cortège et
placé le cadavre au pied de la colonne de Juillet. Des
hommes, la torche au poing, formèrent autour une chapelle
ardente et les fédérés vinrent l’un après
l’autre mettre un baiser au front du
général. »
Illustration de la portée de l’exemple Dombrowski,
plus de soixante ans plus tard, pendant la guerre
d’Espagne, son nom sera donné à une unité polonaise
des Brigades internationales.
Yves Housson
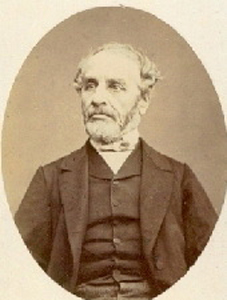 Charles Delecluze
Charles Delecluze 
Lors
de l'entrée des Versaillais dans Paris, il en appelle le 24
mai à une guerre des quartiers : « Place au
peuple, aux combattants aux bras nus ! ». Le
lendemain, 25 mai, désespéré, il ne fera rien pour éviter
la mort sur une barricade au Château-d'Eau, ne voulant en
aucun cas « servir de victime ou de jouet à la
réaction victorieuse ». Considéré comme en fuite bien
que mort, il sera condamné à mort par contumace en1874.
Le
30 mars, il est élu membre de la Commune, il donne sa
démission de député. Lors de l’entrée des versaillais
dans Paris, il appelle le 24 mai à une guerre des quartiers
et déclare « place au peuple, aux combattants aux bras
nus ! » Le lendemain, 25 mai, il est découragé et
désespéré, il ne fera rien pour éviter la mort. Il est
frappé mortellement sur la barricade du
Château-d’Eau, ne voulant en aucun cas « servir
de victime ou de jouet à la réaction victorieuse. Ses
luttes incessantes pour la démocratie et la République, son
courage et sa volonté farouche, malgré les épreuves, lui
vaudront le surnom de « Barre de fer ». Sa
sépulture est une concession gratuite par arrêté
préfectoral en date du 19 janvier
1883.
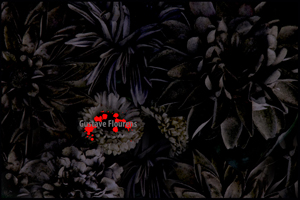 Gustave Flourens
Gustave Flourens 
Le
18 mars 1871, il rejoint le mouvement insurrectionnel de la
Commune de Paris. Flourens est élu membre de la Commune par
le XIXe arrondissement.
Il est nommé général et chargé de la défense de Paris.
C’est un des chefs les plus actifs de la révolte.
Dans une sortie contre les troupes versaillaises au matin
du 3 avril, il est tué dans un corps à corps à Chatou alors
qu’il était désarmé par le capitaine de gendarmerie
Desmarets, d’un coup de sabre qui lui fend la tête.
Ce militaire très courageux sera juge de paix à la Garnache
en Vendée et protégé par le comte de Baudry d’Asson.
Mais
l’homme reste plein de courage. Lors de
l’offensive précipitamment organisée par la Commune
le 3 avril,
en réponse aux premières agressions et atrocités
versaillaises, ses hommes de la 20e légion
occupent l’aile droite de l’armée communarde.
Leur avancée est spectaculaire : de Neuilly à
Asnières, Bois-Colombes, Rueil puis Chatou et Bougival,
conquis après de vifs combats.Versailles n’est plus
qu’à quelques kilomètres. Mais Flourens s’est
isolé, les autres colonnes communardes n’ayant pas
connu le même succès. Il faut ordonner la retraite. Pour sa
part, Flourens ne s’y résigne pas. Lui et Cipriani
s’attardent avec quelques hommes dans une petite
auberge où un parti de gendarmes versaillais les surprend.
Flourens doit se rendre après un court combat. Reconnu, il
est assassiné d’un coup de sabre à la tête par un
capitaine versaillais auquel Thiers donnera la Légion de
déshonneur !
 Raoul Rigault
Raoul Rigault 
Raoult
Rigault fut tué d'une balle dans la tête par un officier
Versaillais le 24 mai 1871 à l'angle de la rue Royer
Collard et de la rue Gay-Lussac. ll avait pour l'occasion
revêtu son uniforme d'officier de la garde nationale qu'il
ne mettait jamais. Son corps resta exposé plusieurs jours
sur place et fut livré à l'ignominie.
 Emile Duval
Emile Duval 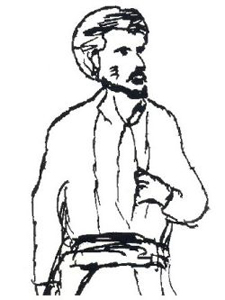
Extraits
du Journal Officiel de la République française sous la
Commune
Mort du général Duval
La Vérité publie le récit suivant d’un témoin qui a
vu mourir le général Duval :
« Les généraux Duval, Henri et près de 1000 gardes
nationaux avaient été cernés dans la redoute de Châtillon,
et contraints de mettre bas les armes. Jusqu’à ce
qu’un tribunal quelconque eut statué sur leur sort,
ils étaient prisonniers de guerre, c’est-à-dire
sacrés.
Les fédérés ont été conduits entre deux rangs de soldats
jusqu’au petit Bicêtre, petit groupe de maisons
situées sur le rebord de la route de Choisy à
Versailles ; un combat très vif a eu lieu ici le dix
sept septembre, une grande fosse surmontée d’une
croix noire indique l’endroit unique où les victimes
de cette journée ont été enterrées.
C’est à cet endroit que le général Vinoy, arrivant de
Versailles avec son état-major, rencontra la colonne des
prisonniers ; il donna l’ordre de
s’arrêter, et, descendant de cheval :
Il y a parmi vous, fit-t-il, un Monsieur Duval qui se fait
appeler général ; je voudrais bien le voir.
C’est moi, dit Duval, avec fierté en sortant des
rangs.
Vous avez aussi deux chefs de bataillon avec vous ?
Les deux officiers désignés sortirent des rangs.
Vous êtes d’affreuses canailles, dit Vinoy, vous avez
fusillé le général Clément Thomas et le général
Lecomte ; vous savez ce qui vous attend. Capitaine,
reprit le signataire de la capitulation de Paris,
s’adressant au commandant de l’escorte, faites
former un peloton de dix chasseurs, Monsieur, passez dans
le champ à côté.
Les trois officiers de la Commune obéirent simplement, ils
sautèrent un petit fossé, suivi du peloton funèbre. Le
général et le commandant furent acculés contre une petite
maisonnette qui, ironie du sort, portait sur sa façade
l’inscription suivante : Duval, horticulteur.
Le général Duval et ses compagnons d’armes ont mis
eux-mêmes habit bas, et deux minutes après ils tombaient
foudroyés, aux cris de : Vive la
commune !
 Pierre Bourgeois
Pierre Bourgeois 
Il
prend part à quelques combats contre l'armée de Versailles.
Il réussit à sortir de Paris mais il est arrêté le 28 juin
à Semur-en-Auxois. Ramené à Versailles, il est emprisonné,
jugé et condamné à mort le 4 septembre 1871. Son recours en
grâce est rejeté le 23 novembre. Il est fusillé en même
temps que Louis Rossel et Théophile Férré au camp de Satory
à Versailles le 28 novembre.
 Eugéne Varlin
Eugéne Varlin 
Le
1er
mai,
Varlin, comme la majorité des internationalistes, s'oppose
à la création du comité de salut public et signe le
manifeste de la minorité Pendant laSemaine Sanglante, il
tente en vain de s'opposer à une exécution d'otages, rue
Haxo et participe aux combats à Beleville.
Le 28 mai, au dernier jour de la Semaine sanglante,
terrible répression menée par l'armée des Versaillais,
Eugène Varlin, reconnu par un prêtre rue Lafayette, est
arrêté et amené à Montmartre où il est lynché, éborgné par
la foule et, finalement, fusillé par les
« lignards ».
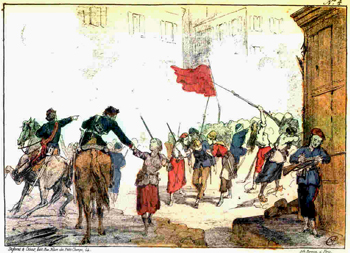 52 femmes fusillées
52 femmes fusillées 
"Le
jeudi 25 mai 1871 alors que les gardes nationaux
abandonnaient la barricade de la rue du Château-d'eau, un
bataillon de femmes vint en courant les remplacer. Ces
femmes, armées de fusils, se battirent admirablement au cri
de : "Vive la Commune!". Nombreuses dans leurs rangs,
étaient des jeunes filles. L'une d'elles, âgée de dix-neuf
ans, habillée en fusilier-marin, se battit comme un démon
et fut tuée d'une balle en plein front. Lorsqu'elles furent
cernées et désarmées par les versaillais, les
cinquantes-deux survivantes furent fusillées."
LES FEMMES
« Les femmes
et les enfants sont l’avant-garde de l’ennemi,
on doit les traiter comme tels... »
Adolphe Thiers

Louise Michel
"Dans
l’aube qui se levait on entendait le tocsin ;
nous montions au pas de charge, sachant qu’au sommet
il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions
mourir pour la liberté. On était comme soulevés de terre.
Nous morts, Paris se fût levé. Les foules à certaines
heures sont l’avant-garde de l’océan humain...
La butte était enveloppée d’une lumière blanche, une
aube splendide de délivrance. La troupe fraternise avec le
peuple, l’insurrection gagne Paris quartier par
quartier, surprenant à la fois le gouvernement et le Comité
central..."
Louise
Michel


Christine Dargent / Nathalie Lemel

Elisabeth Dmitrieff
Fille
illégitime d'un officier tsariste, Elisabeth Dmitrieff est
née en 1851 dans la Province de Pskov. Elle milite très
jeune dans les cercles socialistes de Saint-Petersbourg. En
1868, elle émigre en Suisse où elle participe à la création
de la Section russe de l'Internationale Ouvrière (fondée à
Londres en 1864). Déléguée à Londres elle se lie Karl Marx
qui l'envoie en mission d'information à Paris en mars 1871,
comme représentante du Conseil général de
l'Internationale.. Âgée de vingt ans, elle devient avec
Nathalie Lemel, une des animatrices les plus actives de
l’union des femmes pour la défense de Paris et les
soins aux blessés (fondée le 11 avril 1871 dans la Salle
Larched, 79, rue du Temple). Membre du Comité Central de
l'Union des Femmes, elle s'occupe surtout de questions
politiques et plus particulièrement de l'organisation des
ateliers coopératifs. Elle prend activement part sur les
barricades du Faubourg Saint-Antoine, aux combats de rue de
la Semaine Sanglante (21-28 mai 1871). On ignore comment
elle réussit à échapper aux troupes versaillaises, à
s'enfuir de France et à regagner la Russie en octobre 1871.
Elle y épouse un condamné politique afin de lui éviter la
peine de mort. Elle le suivra en déportation en Sibérie où
elle terminera ses jours en 1910.



Quand
la foule aujourd'hui muette, comme l'océan
grondera,
Qu'à
mourir elle sera prête, la Commune se
lèvera.
Nous
reviendrons foule sans nombre, nous viendrons nous serrant
les mains.
La
mort portera la bannière ; le drapeau noir crêpe de sang
;
Et
pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel
flamboyant.
Louise
Michel, mai 1871
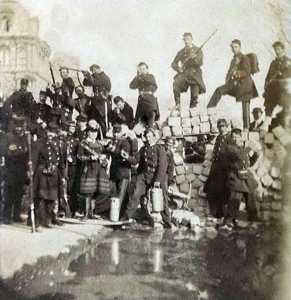

Cantinières sur les
barricades
JULES
VALLES
Aux
morts de 1871
À
TOUS CEUX qui, victimes de l’injustice sociale,
prirent les armes contre un monde mal fait et formèrent,
sous le drapeau de la Commune, la grande fédération des
douleurs,
Je dédie ce livre.
Jules VALLÈS.
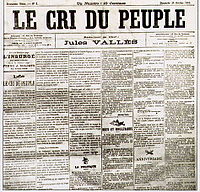
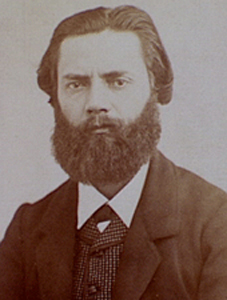
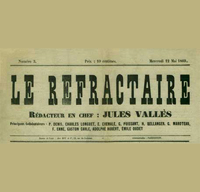
Le
11 juin 1832, naissance de Jules VALLES au Puy-en-Velay
(Haute Loire).Journaliste,
membre de la Commune, propagandiste libertaire et
écrivain.Très
tôt révolté, il prend part à l'agitation révolutionnaire de
1848 à Nantes (où il est renvoyé du lycée) puis il se rend
à Paris. En décembre 1851, il essaie de s'opposer au coup
d'Etat en tentant de soulever le peuple. De retour à
Nantes, son père (qui ne partage pas ses idées) le fait
interner dans un asile. Il n'en sera libéré que trois mois
plus tard, suite aux efforts d’Arnould et Ranc. A
Paris, il se passionne pour les idées de Proudhon, mais à
la suite d'une conspiration contre l'Empereur, il subit une
peine de prison durant l'été 1853. Après divers métiers il
devient journaliste, et publie ses premiers textes. Le 1er
juin 1867, il lance l'hebdomadaire "La Rue" qui s'entoure
de plumes et d'artistes célèbres, de Zola à Courbet. Mais
après 6 mois de parution, le journal est interdit. Vallès
subit, fin 1868, un nouvel emprisonnement à cause d'un
article. De 1869 à 1871, il lancera successivement
plusieurs titres de presse "Le Peuple", « le
Réfractaire », "La Rue" et à partir du 22 février 1871
« Le cri du peuple » qui devient le journal de la
Commune.Cosignataire,
en janvier 1871, de "L'affiche rouge" (appel à
l'insurrection), c'est tout naturellement qu'il devient, le
26 mars 1871, membre de la Commune. Partisan de la
minorité, il s'opposera au Comité de Salut Public. Il
combat sur les barricades durant la Semaine
Sanglante » puis parvient à se réfugier en Angleterre.
Condamné à mort, il ne rentre à Paris qu'à l'amnistie de
1880, il y publie à nouveau, en 1883 (aidé par sa fidèle
collaboratrice Séverine), "Le Cri du peuple", où s'y
s'expriment blanquistes, guesdistes et libertaires. Entre
temps, ses romans autobiographiques "L'enfant", "Le
bachelier" et "L'insurgé", ont été édité sous pseudonyme.
Un dernier roman "Les blouses", sortira avant sa mort qui
survient, après une maladie, le 14 février 1885, (un mois
après l'attaque du journal par deux soudards de la
police).Son
enterrement rassemblera des dizaines de milliers de
personnes, et donnera lieu à des affrontements.
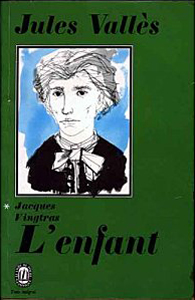
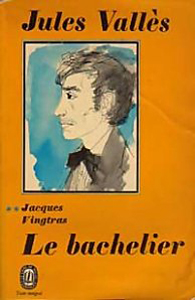
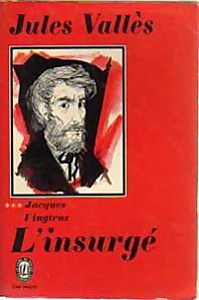
Je
n’ai aucun souvenir du moment où ces livres sont
arrivés entre mes mains, pendant les années lycée. Pourquoi
ceux-ci, je n’avais pas beaucoup d’intérêt pour
le XIXème en général et sa littérature en particulier. Je
me souviens m’être ennuyer ferme sur le bouquin de
Zola « Au bonheur des dames » et avoir réussi
l’oral de français sur un poème de Leconte de Lisle
ou il évoquait les bœufs blanc, écrasés par la
lumière blanche du soleil. Cela avait certainement touché
mon coté rural ! La découverte des nouvelles sombres
de Maupassant et des romans de Barbey D’Aurevilly
seraient pour bientôt. Il semble bien que ce qui a
déclenché la lecture c’est avant tout le graphisme de
la couverture, ou l’on pouvait voir le visage de
l’écrivain au trait avec un fond rouge pour le volume
trois, avec le titre « l’Insurgé »chez
Garnier Flammarion poche. Sans oublié
« l’enfant » et le « bachelier ».
Jules Vallès fait parti de ces gens que l’on aimerait
rencontrer. On ouvre l’Enfant, on passe au Bachelier
sur la lancée et on ferme l’Insurgé avec les yeux
embués, sonné . C’est comme une comédie italienne de
la bonne époque on passe du rire aux larmes et vice versa
en découvrant la vie de Jacques Vingtras . Lorsqu’il
s’éteint il murmure « j’ai beaucoup
souffert ». Il n’y pas de lamentation mais une
écriture vive, moderne, mordante avec une dose de violence
et un humour plein de désespoir…